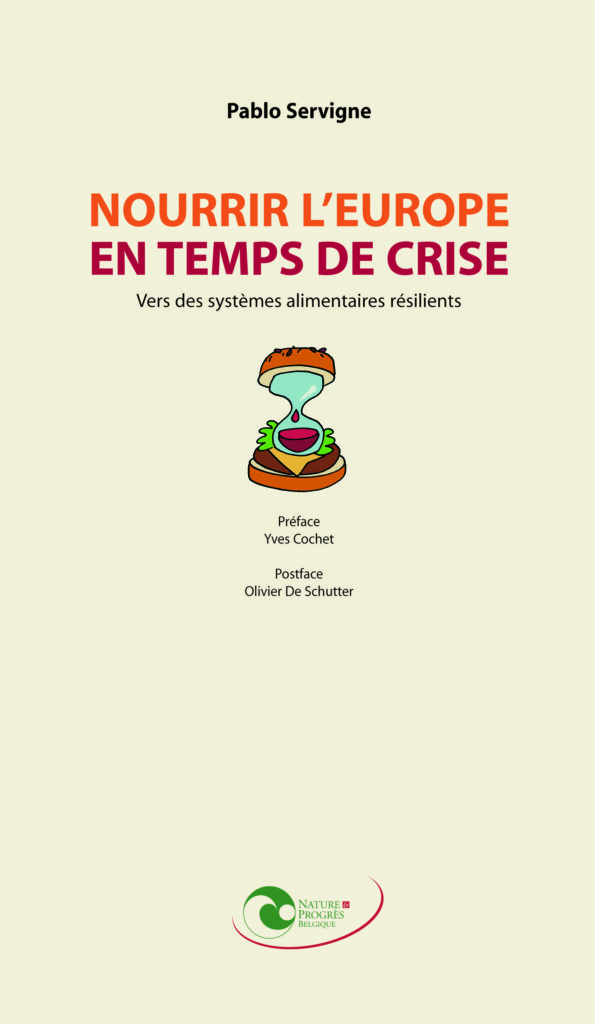Entretien avec Pablo Servigne sur « l’effondrement qui vient »
Pablo Servigne est agronome, docteur en science à l’Université libre de Bruxelles et membre du Groupe interdisciplinaire de Recherche en Agroécologie. Il a quitté le monde universitaire en 2008 pour se consacrer pleinement au mouvement de la transition en temps que « chercheur indépendant ». Consulté par le Parlement européen et les Nations Unies pour avoir pointé du doigt la fragilité de nos systèmes alimentaires, il écrit régulièrement des ouvrages pour expliquer comment tout peut s’effondrer. Comment tout peut s’effondrer (Le Seuil, 2015).
Pensez-vous réellement pouvoir convaincre de la chute imminente de nos sociétés ?
Même avec des arguments scientifiques, c’est dur de convaincre quelqu’un qui refuse catégoriquement de croire à la fin de notre système. En revanche, il y a en a beaucoup qui sont sensibilisés sur une partie du problème, c’est ceux-là qu’il est possible de faire basculer. Notre civilisation est une voiture thermo-industrielle. Elle ne va pas droit dans le mur mais sort de la route et est en panne. Il n’y a plus d’essence dans le réservoir, mais nous continuons à appuyer à fond sur l’accélérateur car nous ne voulons pas remettre en cause nos mythes fondateurs, comme celui de la croissance infinie dans un monde pourtant fini. Notre volant est bloqué car les nouvelles inventions techniques envahissent systématiquement nos sociétés, et tous les clignotants s’allument car comme tout est connecté, tout se fragilise mutuellement.
Les déplacements de populations actuels s’incluent-ils dans la mosaïque de l’effondrement à venir ?
Oui, tout est vraiment relié. On ne peut pas raisonner en terme mono-causal, en cloisonnant le thème politique, religieux, économique, migratoire ou climatique. Tout est interconnecté. Des études montrent que toutes les grandes crises du Moyen-Âge étaient causées par des famines, toutes causées par des crises économiques majeures, toutes causées par des crises climatiques graves, comme des sécheresses par exemple. Les migrations sont l’une des conséquences du grand tableau de l’effondrement que l’on a sous nos yeux actuellement. Les paramètres de ce tableau sont dramatiques : sécheresses, érosions des sols, déforestations, perturbations du cycle de l’azote, apparition de zones mortes en mer, etc. La destruction irréversible de certains systèmes a déjà commencé et les réfugiés climatiques en sont l’une des conséquences. On ne peut pas ne pas voir les grands phénomènes migratoires comme des phénomènes écologistes. Et ce ne sont pas des crises car il n’y aura pas de retour à la normal, c’est impossible. C’est pour cela qu’on a choisi le mot « effondrement ».
Que répondez-vous à ceux qui sont persuadés qu’on trouvera forcément un moyen de s’en sortir, comme une nouvelle technologie, voire une nouvelle planète ?
C’est une croyance qui ne repose sur aucun fait, sur aucune analyse scientifique. C’est une certitude qui n’est pas étayée. Dire que « de toute façon, ça ira mieux », c’est juste un moyen de se faire plaisir, de se rassurer. Je comprends que le mythe prométhéen soit très ancré dans notre civilisation, avec l’idée que l’on puisse toujours être maître de son destin, mais ça ne veut pas dire pour autant qu’il corresponde à la réalité. En déclarant « on finira forcément par s’en sortir », vous ne démontrez rien. Après on me dit souvent que de tout temps, il y a eu des lanceurs d’alertes, des annonciateurs de mauvaise augure, des Cassandre qui prédisent la fin du monde. C’est vrai, et de tout temps, il y a eu des gens qui croyaient à la continuité de leur civilisation, même à la veille de bouleversements majeurs. On est souvent plus dans le domaine du mythe que dans la raison quand on aborde ces questions-là. Si on s’adresse à quelqu’un qui croit au mythe du progrès, les arguments scientifiques n’ont aucune valeur. On ne pourra pas les convaincre avec des chiffres. C’est ça la puissance de l’être humain : on préfère détourner les faits pour continuer à faire vivre nos mythes.
Quel est le moteur de la mobilisation collective si de toute façon, tout va s’effondrer. Comme le poète grec Yanis Youlountas, pensez-vous qu’il faut « résister par dignité plutôt que par espérance puisque l’espoir nous fait croire en un monde qui n’existe plus » ?
La dignité a son importance et l’indignation est un puissant moteur de conscience, mais ça ne suffit pas. Il faut faire le deuil de notre civilisation. C’est déjà foutu. Je le répète : c’est déjà foutu. Il n’y a pas de solutions permettant de continuer à faire perdurer notre système. Accepter cet état de fait, c’est libérer ses émotions – peur, tristesse, colère, déni – et aller de l’avant c’est-à-dire recréer un monde ; c’est donc une théorie de la mort et de la renaissance. Le développement « durable », le capitalisme vert et toutes ces illusions entretiennent l’idée qu’il est possible de transformer le système actuel, mais c’est un mensonge. On n’empêche pas de tomber le grand arbre de la forêt. On le laisse mourir pour laisser de la place aux jeunes pousses. Si on n’admet pas la fin de notre système, c’est très difficile d’avancer et surtout, de nourrir un nouvel imaginaire positif pour le futur. On imagine toujours Mad Max quand on parle d’effondrement, c’est-à-dire un univers chaotique. Admettre que notre monde est mort ne nous empêche pourtant pas de créer de nouveaux espoirs, plus positifs. Et il ne s’agit pas réellement d’espérance, mais de lucidité. Désormais, les utopistes ont changé de camp. Ce sont ceux qui croient pouvoir continuer comme avant alors qu’ils sont hors des réalités.
Vous avez évoqué les émotions. Comment relier la réflexion intérieure d’un individu, c’est-à-dire ce qu’il ressent, à des destins communs et des histoires communes ?
Bonne question à laquelle je n’ai pas de réponse. Dans l’analyse scientifique, on n’explore jamais le continent de l’imaginaire et des émotions. En politique, ils le font un peu avec ce qu’on appelle le « story telling ». Ils sont très forts pour raconter de belles histoires, même si les émotions restent encore largement taboues. La colère fait peur, la tristesse vous fait passer pour un faible, etc. Comment lier des émotions qui sont absolument indispensables pour aller de l’avant, à un projet politique commun ? C’est la question à creuser dans les prochaines années. Je pense qu’il faut davantage interpeller nos hommes politiques sur des émotions plutôt que sur des chiffres. Le projet libéral cherche à déconnecter le plus possible les structures politiques des passions, des pulsions, des sentiments. Il faut le marché le plus « neutre » possible, le plus optimal, etc. Nous considérons notre science, la « collapsologie », comme une science de l’intuition. Les sciences dures ne permettent pas toujours de comprendre nos sociétés tellement nos structures sont devenues complexes. On ne peut donc plus faire l’économie de l’intuition et des pulsions, c’est-à-dire des émotions, pour bâtir un programme politique.
Vous expliquez que le niveau local est le moyen le plus efficace pour créer de nouveaux mondes et de nouveaux imaginaires. Est-ce que ce n’est pas nier la puissance de nos adversaires qui, eux, sont organisés en superstructures ?
Je ne dis pas que le local est le moyen le plus efficace, mais plutôt l’échelle où l’on retrouve le plus rapidement et facilement notre puissance d’agir, notre pouvoir, entendu comme une capacité d’action et non de domination. Aller voter un jour tous les cinq ans, ce n’est pas exercer le pouvoir. L’échelon communal, municipal est très puissant car on a accès au maire, au conseil local, etc. Tous les travaux autour du municipalisme libertaire sont très intéressants et méritent d’être développés. Quand tu te mets à combattre une grande structure en t’organisant comme eux en grande structure, tu prends le risque de reproduire les défauts que tu critiquais auparavant. Il y a beaucoup de joie à retrouver une puissance d’agir au niveau local plutôt que de s’affronter à un gouvernement lointain.
Il parait pourtant délicat de faire l’économie d’un pouvoir national. Pourquoi ne pas prévoir des assemblées du court terme, pour le local, et une assemblée du long terme, à un niveau plus global ?
Oui, mais on prend rapidement le risque de se retrouver avec un conseil des sages, et je trouve cela très dangereux. Qui serait le sage ? Je pense que la gestion du long terme peut également se faire au niveau local et n’a pas forcément à être réservée à un échelon supérieur.
Vous affirmez souvent que nous allons tous finir paysans. Pourquoi ?
Un baril de pétrole, c’est environ 25 000 heures de travail humain en termes de joules, soit à peu près une personne travaillant 40h par semaine pendant douze ans. Un plein d’essence, c’est donc quatre ans de travail humain. Quand il n’y aura plus de pétrole bon marché, les machines agricoles resteront sur le carreau et il faudra des masses de main d’œuvre considérables pour continuer à nourrir tout le monde. Dans mon premier livre, Nourrir l’Europe en temps de crise (Nature & Progrès, 2014), commandé par le Parlement européen et présenté au rapporteur des Nations Unies pour le droit à l’alimentation, j’explique que l’on va connaître une chute rapide de nos systèmes alimentaires industriels et que d’ici 10 ou 15 ans, il faudra 120 millions de nouveaux paysans pour nourrir l’Europe. Selon l’hypothèse la plus optimiste, une personne sur quatre sera bientôt agriculteur en Europe. Autant l’anticiper dès maintenant.
Jules Panetier
Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :
ARTICLE SUIVANT :